ARCHIVES – 1980
Jean-François GAUTIER :
Julien Freund devant l’ennemi
« Pas de politique sans ennemi », dit le Prof. Julien Freund. Il analyse la décadence de l’Europe : ennemie d’elle-même, elle s’oppose aux valeurs qui l’ont forgée.
 « Un âge historique, celui de la Renaissance, est en train de se désagréger. L’Europe est désormais impuissante à assumer le destin qui fut le sien durant des siècles. Nous assistons à la fin de la première civilisation de caractère universel que le monde ait connu ».
« Un âge historique, celui de la Renaissance, est en train de se désagréger. L’Europe est désormais impuissante à assumer le destin qui fut le sien durant des siècles. Nous assistons à la fin de la première civilisation de caractère universel que le monde ait connu ».
Sous le titre « La fin de la Renaissance », M. Julien Freund vient de publier un livre qu’il aurait pu tout aussi bien intituler « La décadence européenne ». L’expression revient souvent sous sa plume au fil des pages. Mais cet ancien professeur de la faculté de Strasbourg ne prêche pas le désarroi. Son livre ne veut être qu’un constat. Il est aussi un plaidoyer pour le « vieil esprit » européen.
Cheveux blancs coiffés en brosse, lunettes d’écaille, lèvres fines et large sourire, M. Freund est l’un des maîtres de la philosophie politique en Europe. Bien loin des modes de l’intelligentsia marxiste. Dans le restaurant des grands boulevards où je le rencontre, il dénombre en riant les éditeurs qui ont refusé son livre. Théoricien de la politique, il ne s’étonne pas d’avoir quelques ennemis.
C’est une notion capitale, me dit-il. Sans le sens de l’ennemi, il n’y a plus d’amis, plus d’alliances, et plus de politique.
La carrière de M. Freund a commencé bien loin des bibliothèques universitaires. Socialisant, il avait rejoint dès janvier 1941 le réseau « Libération ». Quelques mois d’opérations et c’est l’emprisonnement pour deux ans.
Une expérience extraordinaire m’assure-t-il. Dans la cellule de droite, Emmanuel Mounier, abîmé en prières, récitait son rosaire. A gauche, Jean Nocher rimait des poèmes érotiques sur Paname. Et moi, au milieu, je relisais Spinoza.
— Quels étaient les contacts avec le « personnaliste » Mounier ?
Très réduits. Il aimait les discussions sérieuses mais il manquait de rigueur. Je lui ai demandé un jour des précisions sur ses idées en économie. La réponse a été nébuleuse, il m’a avoué qu’il en parlait parce qu’il fallait en parler.
A la Libération, M. Freund est conseiller municipal de Sarrebourg, secrétaire départemental de l’UDSR, rédacteur de L’Avenir lorrain et professeur de lycée. En 1947, il abandonne du jour au lendemain toute activité politique.
La déception de la IV° République a été immense, explique-t-il. En prison, je rêvais une politique. Je me suis rendu compte qu’elle était inapplicable. Il fallait penser autre chose.
Après l’agrégation de philosophie, en 1949, M. Freund commence une thèse sur les problèmes politiques. Il emprunte une pile de livres à l’université de Strasbourg. Parmi ceux-ci, La notion du politique du théoricien allemand Carl Schmitt.
Un ouvrage sidérant, dit le Prof. Freund (il en préfacera vingt-deux ans plus tard la traduction française chez Calmann-Lévy). Ce fut une révolution, un enthousiasme extraordinaire.
Trente ans après, il revit encore son « illumination » d’étudiant. Comme Descartes découvrant son « cogito », il avait trouvé l’idée maîtresse de sa pensée dans la distinction de l’ami et de l’ennemi que Schmitt met à la base de toute politique.
Il oublie la salle de restaurant où nous nous trouvons, précise tel aspect de sa pensée, s’aide d’un geste rapide, comme s’il saisissait une idée dans l’air.
Je n’avais en tête que « l’adversaire », celui que l’on souhaite toujours récupérer. Schmitt m’apprenait que toute l’impuissance de la politique résidait là.
— A qui en avez-vous parlé ?
A Paul Ricoeur, le futur doyen de Nanterre, qui enseignait alors à Strasbourg. Je croyais que Schmitt était mort. Ricoeur m’a dit : « Il vit toujours en Allemagne et c’était un nazi ». Ce fut une douche glacée.
Comment le résistant socialiste pouvait-il retrouver sa propre pensée dans celle de son ennemi ? M. Freund a lu et relu l’ouvrage, « quarante fois en neuf ans », précise-t-il. En 1959, il écrit à Carl Schmitt, le rencontre à Colmar et devient son ami. Dans sa préface à La notion du politique, il notera plus tard : « On a pris l’habitude de juger son œuvre non pour elle-même mais d’après les fautes que l’on impute à l’homme (…). Parce que la sottise est très répandue, même en milieu intellectuel ».
La thèse de M. Freund a elle-même dérangé dans l’Université, à cause de l’un de ses présupposés fondamentaux : « Pas de politique sans ennemi ». Son premier directeur de travaux, Jean Hippolyte, spécialiste de Hegel et l’un des maîtres de la Sorbonne, refusa au nom du pacifisme de présider un jury de thèse sur un tel sujet. M. Freund trouva alors en Raymond Aron un nouveau « patron ».
En 1965, peu avant la soutenance, Aron me demanda si Hippolyte ne pouvait pas faire partie du jury. J’ai bien entendu accepté, en précisant qu’il n’était pas mauvais d’avoir son ennemi en face de soi. Je crois qu’Aron l’a interprété comme une idée fixe.
— La réaction d’Hippolyte ?
Il est venu. Il a reconnu en pleine Sorbonne s’être trompé dans son premier jugement sur mon travail. Il a ajouté que, si j’avais eu raison dans mes conclusions sur la nature du politique, il ne lui restait plus qu’à cultiver son jardin.
— C’était honnête de sa part.
Je lui ai surtout répondu qu’il avait commis deux erreurs. La première, il l’avait reconnue. La seconde était de croire que la bienveillance supprime l’ennemi. Erreur grave, car vous pouvez manifester toute l’amitié que vous voudrez, ce n’est pas vous qui désignez l’ennemi, c’est lui qui vous désigne. Et il vous empêchera de cultiver votre jardin.
Hippolyte répondit : « Dans ce cas, il ne me reste que le suicide ».
Réponse typique d’un intellectuel pacifiste, commente M. Freund. Il préférait s’anéantir plutôt que de reconnaître la réalité.
M. Freund retrouve là l’un des thèmes de La fin de la Renaissance. Pour lui, la décadence de l’Europe a partie liée avec la haine de soi-même dont l’Occident fait preuve dans ses relations complexées avec le tiers monde ; et au reniement de sa puissance, qui est le moteur de la diplomatie européenne.
M. Valéry Giscard d’Estaing souhaite, dans sa préface au livre de son ami Samuel Pisar (Transactions entre l’Est et l’Ouest, Dunod), « la mise en œuvre concrète de la coexistence sous la forme la plus pratique des relations humaines : le commerce ». Il ajoute, pour s’en féliciter : « La grandeur des relations commerciales est qu’il n’y a ni succès ni défaite ».
Giscard croit que le dialogue avec Brejnev suffit, me dit le Prof. Freund. Il n’a pas compris ce qu’est un ennemi. La politique n’est pas un problème de concordances de vues. Son enjeu est vital au sens exact du terme : c’est votre vie que l’ennemi menace.
— Qui le dit en Europe ?
Pas grand monde. Contrairement à ce que l’on croit, l’intellectualisation des problèmes est une forme de la décadence européenne. Elle perd tout sens de la stratégie, de la tactique sur le terrain. De Gaulle possédait ce sens-là, Adenauer aussi. Helmut Schmidt, que je connais bien, l’avait aussi. Mais Giscard l’a convaincu. Sans lui, il ne serait jamais allé à Moscou.
— Vous n’avez plus d’admirations politiques ?
Personne depuis De Gaulle. Mais Teng Hsiao-ping m’impressionne. Le procès avec la veuve de Mao est un bouleversement. Teng a le sens du risque, et surtout des conséquences du risque. Avec un tel goût de l’aventure, il peut faire quelque chose.
La femme du dieu vivant au banc des accusés, Confucius réhabilité, tels seraient les leviers de M. Teng pour rouvrir l’aventure chinoise. Un passé limité aux péripéties du dieu vivant Mao, la Longue Marche s’épuisant depuis la révolution culturelle, il fallait faire remonter la mémoire en deçà pour débloquer l’avenir. M. Teng pense-t-il à tout cela ? M. Freund ne prend pas le temps de détailler ses intuitions sur la stratégie chinoise.
L’Europe, poursuit-il, c’était cela. Une manière de parier sur l’avenir sans rechercher d’abord un « consensus ». C’était aussi la ruse, une vertu maintenant discréditée. On la confond avec la perfidie, la bassesse ou la laideur morale. Mais que vous donne votre ennemi, si ce n’est l’intelligence de la ruse ? Sans elle, vous perdez.
M. Freund me dit avoir eu Tocqueville devant les yeux en écrivant son dernier livre et, à un moindre degré, Spengler. Il cite aussi Machiavel. Méditations sur les anciens ?
— Elle est indispensable, répond-il.
Les enseignants s’imaginent que de débrider l’imagination des enfants suffit à leur former l’intelligence. Ils oublient la mémoire, sans laquelle il n’y a plus ni passé ni avenir. Rappelez-vous Nietzsche : « L’avenir appartient à celui qui a la plus longue mémoire ». Tout cela commence avec l’histoire, la littérature, la récitation. Apprendre La Fontaine, c’est l’embryon de la mémoire nietzschéenne.
— Le terme « conservateur » est décrié. Vous le revendiquez ?
Conservateur, réactionnaire, tout ce que vous voulez. On me le dit parfois en forme d’insulte. L’important, Descartes l’a vu dans sa IV° méditation : dans toute création, il y a un phénomène de conservation. L’application pratique est évidente : celui qui est incapable de conserver ne crée plus rien.
— La leçon est-elle valable pour l’Europe ?
Plus que jamais. L’intelligentsia a perdu le sens de la méditation, de la pensée qui revient sur elle-même pour se reprendre. S’il y a encore des chances pour l’Europe, il faut d’abord les discerner selon le vieil esprit de la Renaissance. Notre histoire est celle de la conquête d’un espace. L’Europe ne peut pas se contrôler si elle ne contrôle d’abord son espace.
— Avec l’aide d’une couverture américaine ?
Là, il faut être précis. Les Russes ont hérité de l’esprit européen de la Renaissance. Ils ont le sentiment d’une aventure illimitée devant eux. A terme, cela signifie qu’ils veulent nous contrôler. Si nous n’avons pas les moyens de nous défendre seuls, une alliance est nécessaire.
— N’est-ce pas une dépendance ?
L’alliance n’est pas une subordination. Elle le devient si, en défendant l’Europe, nous nous donnons un rôle de couverture des avant-postes américains. Ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit de « notre » espace. Kissinger l’avait compris. Il avait une conception européenne des problèmes stratégiques. A cause de cela, les Européens étaient furieux contre lui. Alors qu’il a appris l’essentiel du Général De Gaulle.
Dehors, lorsque je quitte le Prof. Freund, il remet son béret, devenu un autre lui-même « depuis le jour où il a été interdit par les Allemands ». Il y a du collégien provocateur chez cet homme rieur et affable. Et une terrible lucidité. Dans son livre, il est une question à laquelle il ne répond pas : « Les Européens, demande-t-il, seraient-ils capables de mener une guerre ? ».
Jean-François GAUTIER.
(ex : « Valeurs actuelles », 22 décembre 1980).



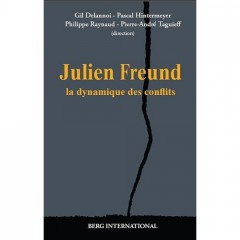

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg « Un âge historique, celui de la Renaissance, est en train de se désagréger. L’Europe est désormais impuissante à assumer le destin qui fut le sien durant des siècles. Nous assistons à la fin de la première civilisation de caractère universel que le monde ait connu ».
« Un âge historique, celui de la Renaissance, est en train de se désagréger. L’Europe est désormais impuissante à assumer le destin qui fut le sien durant des siècles. Nous assistons à la fin de la première civilisation de caractère universel que le monde ait connu ».